|
 e
suis né dans un tonneau au fond d’un grenier à foin ; la lumière tombait sur mes
paupières fermées, en sorte que, les huit premiers jours, tout me parut couleur
de rose. e
suis né dans un tonneau au fond d’un grenier à foin ; la lumière tombait sur mes
paupières fermées, en sorte que, les huit premiers jours, tout me parut couleur
de rose.
Le huitième, ce
fut encore mieux ; je regardai, et vis une grande chute de clarté sur l’ombre
noire ; la poussière et les insectes y dansaient. Le foin était chaud et odorant
; les araignées dormaient pendues aux tuiles ; les moucherons bourdonnaient ;
tout le monde avait l’air heureux ; cela m’enhardit, je voulus toucher la plaque
blanche où tourbillonnaient ces petits diamants et qui rejoignait le toit par
une colonne d’or. Je roulai comme une boue, j’eus les yeux brûlés, les côtes
meurtries ; j’étranglais, et je toussai jusqu’au soir.
II
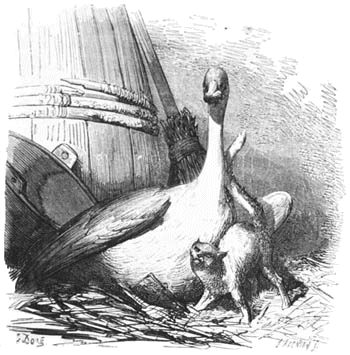  es pattes étant
devenues solides, je sortis et fis bientôt amitié avec une oie, bête estimable,
car elle avait le ventre tiède ; je me blottissais dessous, et pendant ce temps
ses discours philosophiques me formaient. Elle disait que la basse-cour était
une république d’alliés ; que le plus industrieux, l’homme, avait été choisi
pour chef, et que les chiens, quoique turbulents, étaient nos gardiens. Je
pleurais d’attendrissement sous le ventre de ma bonne amie. es pattes étant
devenues solides, je sortis et fis bientôt amitié avec une oie, bête estimable,
car elle avait le ventre tiède ; je me blottissais dessous, et pendant ce temps
ses discours philosophiques me formaient. Elle disait que la basse-cour était
une république d’alliés ; que le plus industrieux, l’homme, avait été choisi
pour chef, et que les chiens, quoique turbulents, étaient nos gardiens. Je
pleurais d’attendrissement sous le ventre de ma bonne amie.
Un matin la
cuisinière approcha d’un air bonasse, montrant dans la main une poignée d’orge.
L’oie tendit le cou, que la cuisinière empoigna, tirant un grand couteau. Mon
oncle, philosophe alerte, accourut et commença à exhorter l’oie, qui poussait
des cris inconvenants : "Chère sœur, disait-il, le fermier, ayant mangé votre
chair, aura l’intelligence plus nette et veillera mieux à notre bien-être ; et les
chiens, s’étant nourris de vos os, seront plus capables de nous défendre."
Là-dessus l’oie se tut, car sa tête était coupée, et une sorte de tuyau rouge
s’avança hors du cou qui saignait. Mon oncle courut à la tête et l’emporta
prestement ; pour moi, un peu effarouché, j’approchai de la mare de sang, et
sans réfléchir, j’y trempai ma langue ; ce sang était bien bon, et j’allai à la
cuisine pour voir si je n’en aurais pas davantage.
III
 on
oncle, animal fort expérimenté et très vieux, m’a enseigné l’histoire
universelle. on
oncle, animal fort expérimenté et très vieux, m’a enseigné l’histoire
universelle.
À l’origine des
choses, quand il naquit, le maître étant mort, les enfants à l’enterrement, les
valets à la danse, tous les animaux se trouvèrent libres. Ce fut un tintamarre
épouvantable ; un dindon ayant de trop belles plumes fut mis à nu par ses
confrères. Le soir, un furet, s’étant insinué, suça à la veine du cou les trois
quarts des combattants, lesquels, naturellement, ne crièrent plus. Le spectacle
était beau dans la basse-cour ; le chiens çà et là avalaient un canard ; les
chevaux par gaieté cassaient l’échine des chiens ; mon oncle lui-même croqua une
demi-douzaine de petits poulets. C’était le bon temps, dit-il.
Le soir, les gens
étant rentrés, les coups de fouet commencèrent. Mon oncle en reçut un qui lui
emporta une bande de poils. Les chiens, bien sanglés et à l’attache, hurlèrent
de repentir et léchèrent les mains du nouveau maître. Les chevaux reprirent leur
dossée avec un zèle administratif. Les volailles protégées, poussèrent des
gloussements de bénédiction ; seulement, au bout de six mois, quand passa le
coquetier, d’un coup on en saigna cinquante. Les oies, au nombre desquelles
était ma bonne amie défunte, battirent des ailes, disant que tout était dans
l’ordre, et louant le fermier, bienfaiteur du public.
IV
 on
oncle, quoique morose, avoue que les choses vont mieux qu’autrefois. Il dit que
d’abord notre race fut sauvage, et qu’il y a encore dans les bois des chat
pareils à nos premiers ancêtres, lesquels attrapent de loin en loin un mulot ou
un loir, plus souvent des coups de fusil. D’autres, secs, le poil ras, trottent
sur les gouttières et trouvent que les souris sont bien rares. Pour nous, élevés
au comble de la félicité terrestre, nous remuons flatteusement la queue à la
cuisine, nous poussons de petits gémissements tendres, nous léchons les plats
vides, et c’est tout au plus si par journée nous emboursons une douzaine de
claques. on
oncle, quoique morose, avoue que les choses vont mieux qu’autrefois. Il dit que
d’abord notre race fut sauvage, et qu’il y a encore dans les bois des chat
pareils à nos premiers ancêtres, lesquels attrapent de loin en loin un mulot ou
un loir, plus souvent des coups de fusil. D’autres, secs, le poil ras, trottent
sur les gouttières et trouvent que les souris sont bien rares. Pour nous, élevés
au comble de la félicité terrestre, nous remuons flatteusement la queue à la
cuisine, nous poussons de petits gémissements tendres, nous léchons les plats
vides, et c’est tout au plus si par journée nous emboursons une douzaine de
claques.
V
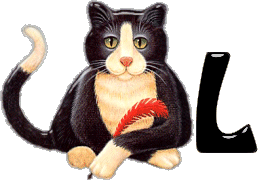 a
musique est un art céleste, il est certain que notre race en a le privilège ;
elle sort du plus profond de nos entrailles ; les hommes le savent si bien,
qu’ils nous les empruntent, quand avec leurs violons ils veulent nous imiter. a
musique est un art céleste, il est certain que notre race en a le privilège ;
elle sort du plus profond de nos entrailles ; les hommes le savent si bien,
qu’ils nous les empruntent, quand avec leurs violons ils veulent nous imiter.
Deux choses nous
inspirent ces chants célestes : la vue des étoiles et l’amour. Les hommes,
maladroits copistes, s’entassent ridiculement dans une salle basse, et
sautillent, croyant nous égaler. C’est sur la cime des toits, dans la splendeur
des nuits, quand tout le poil frissonne, que peut s’exhaler la mélodie divine.
Par jalousie ils nous maudissent et nous jettent des pierres. Qu’ils crèvent de
rage ; jamais leur voix fade n’atteindra ces graves grondements, ces perçantes
notes, ces folles arabesques, ces fantaisies inspirées et imprévues qui
amollissent l’âme de la chatte la plus rebelle, et nous la livrent frémissante,
pendant que là-haut les voluptueuses étoiles tremblent et que la lune pâlit
d’amour.
Que la jeunesse
est heureuse, et qu’il est dur de perdre les illusions saintes ! Et moi aussi
j’ai aimé et j’ai couru sur les toits en modulant des roulements de basse. Une
de mes cousines en fut touchée, et deux mois après mit au monde six petits chats
blancs et roses. J’accourus, et voulus les manger : c’était bien mon droit,
puisque j’étais leur père. Qui le croirait ? ma cousine, mon épouse, à qui je
voulais faire sa part du festin, me sauta aux yeux. Cette brutalité m’indigna et
je l’étranglai sur la place ; après quoi j’engloutis la portée tout entière.
Mais les malheureux petits drôles n’étaient bons à rien, pas même à nourrir leur
père : leur chair flasque me pesa trois jours sur l’estomac. Dégoûté des grandes
passions, je renonçai à la musique, et m’en retournai à la cuisine.
VI
 ’ai
beaucoup pensé au bonheur idéal, et je pense avoir fait là-dessus des
découvertes notables. ’ai
beaucoup pensé au bonheur idéal, et je pense avoir fait là-dessus des
découvertes notables.
Évidemment il
consiste, lorsqu’il fait chaud, à sommeiller près de la mare. Une odeur
délicieuse sort du fumier qui fermente ; les brins de paille lustrés luisent au
soleil. Les dindons tournent l’æil amoureusement, et laissent tomber sur leur
bec leur panache de chair rouge. Les poules creusent la paille et enfoncent leur
large ventre pour aspirer la chaleur qui monte. La mare scintille, fourmillante
d’insectes qui grouillent et font lever des bulles à sa surface. L’âpre
blancheur des murs rend plus profond les enfoncements bleuâtres où le moucherons
bruissent. Les yeux demi-fermés, on rêve, et comme on ne pense plus guère, on ne
souhaite plus rien.
L’hiver, la
félicité est d’être assis au coin du feu de la cuisine. Les petites langues de la
flamme lèchent la bûche et se dardent parmi des pétillements, les sarments
craquent et se tordent, et la fumée enroulée monte dans le conduit noir jusqu’au
ciel. Cependant la broche tourne, d’un tic-tac harmonieux et caressant. La
volaille embrochée roussit, brunit, devient splendide ; la graisse qui l’humecte
adoucit ses teintes ; une odeur réjouissante vient picoter l’odorat ; on passe
involontairement sa langue sur les lèvres ; on respire les divines émanations du
lard ; les yeux au ciel, dans une grave extase, on attend que la cuisinière
débroche la bête et vous en offre ce qui vous revient.
Celui qui mange
est heureux ; celui qui digère est plus heureux ; celui qui sommeille en
digérant est plus heureux encore. Tout le reste n’est que vanité et impatience
d’esprit. Le mortel fortuné est celui qui, chaudement roulé en boule et le
ventre plein, sent son estomac qui opère et sa peau qui s’épanouit. Un
chatouillement exquis pénètre et remue doucement les fibres. Le dehors et le
dedans jouissent par tous leurs nerfs. Certainement si le monde est un grand
Dieu bienheureux, comme nos sages le disent, la terre doit être un ventre immense
occupé de toute éternité à digérer les créatures et à chauffer sa peau ronde au
soleil.
VII
 on
esprit s’est fort agrandi par la réflexion. Par une méthode sûre, des
conjectures solides et une attention soutenue, j’ai pénétré plusieurs secrets de
la nature. on
esprit s’est fort agrandi par la réflexion. Par une méthode sûre, des
conjectures solides et une attention soutenue, j’ai pénétré plusieurs secrets de
la nature.
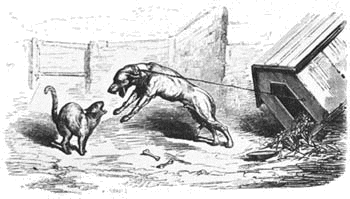 Le chien est un
animal si difforme, d’un caractère si désordonné, que de tout temps il a été
considéré comme un monstre, né et formé en dépit de toutes les lois. En effet,
lorsque le repos est l’état naturel, comment expliquer qu’un animal soit
toujours remuant, affairé, et cela sans but ni besoin, lors même qu’il est repu
et n’a point peur ? Lorsque la beauté consiste universellement dans la
souplesse, la grâce et la prudence, comment admettre qu’un animal soit toujours
brutal, hurlant, fou, se jetant au nez des gens, courant après les coups de pied
et les rebuffades ? Lorsque le favori et le chef-d'œuvre de la création est le
chat, comment comprendre qu’un animal le haïsse, coure sur lui sans en avoir
reçu une seule égratignure, et lui casse les reins sans avoir envie de manger sa
chair ? Le chien est un
animal si difforme, d’un caractère si désordonné, que de tout temps il a été
considéré comme un monstre, né et formé en dépit de toutes les lois. En effet,
lorsque le repos est l’état naturel, comment expliquer qu’un animal soit
toujours remuant, affairé, et cela sans but ni besoin, lors même qu’il est repu
et n’a point peur ? Lorsque la beauté consiste universellement dans la
souplesse, la grâce et la prudence, comment admettre qu’un animal soit toujours
brutal, hurlant, fou, se jetant au nez des gens, courant après les coups de pied
et les rebuffades ? Lorsque le favori et le chef-d'œuvre de la création est le
chat, comment comprendre qu’un animal le haïsse, coure sur lui sans en avoir
reçu une seule égratignure, et lui casse les reins sans avoir envie de manger sa
chair ?
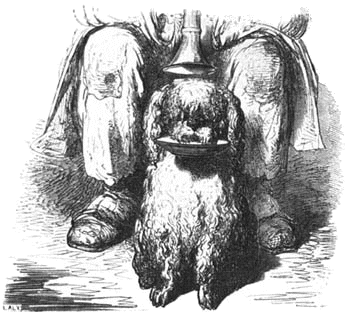 Ces contrariétés
prouvent que les chien sont des damnés ; très certainement les âmes coupables et
punies passent dans leurs corps. Elles y souffrent : c’est pourquoi ils se
tracassent et s’agitent sans cesse. Elles ont perdu la raison : c’est pourquoi
ils gâtent tout, se font battre, et sont enchaînés les trois quarts du jour.
Elles haïssent le beau et le bien : c’est pourquoi ils tâchent de nous
étrangler. Ces contrariétés
prouvent que les chien sont des damnés ; très certainement les âmes coupables et
punies passent dans leurs corps. Elles y souffrent : c’est pourquoi ils se
tracassent et s’agitent sans cesse. Elles ont perdu la raison : c’est pourquoi
ils gâtent tout, se font battre, et sont enchaînés les trois quarts du jour.
Elles haïssent le beau et le bien : c’est pourquoi ils tâchent de nous
étrangler.
VIII
 eu
à peu l’esprit se dégage des préjugés dans lesquels on l’a nourri ; la lumière
se fait ; il pense par lui-même : c’est ainsi que j’ai atteint la véritable
explication des choses. eu
à peu l’esprit se dégage des préjugés dans lesquels on l’a nourri ; la lumière
se fait ; il pense par lui-même : c’est ainsi que j’ai atteint la véritable
explication des choses.
Nos premiers
ancêtres (et les chats de gouttière ont gardé cette croyance) disaient que le
ciel est un grenier extrêmement élevé, bien couvert, où le soleil ne fait jamais
mal aux yeux. Dans ce grenier, disait ma tante, il y a un troupeau de rats si
gras qu’ils marchent à peine, et plus on en mange, plus il en revient.
Mais il est
évident que ceci est une opinion de pauvres hères, lesquels, n’ayant jamais
mangé que du rat, n’imaginaient pas une meilleure cuisine. Puis les greniers
sont couleur de bois ou gris, et le ciel est bleu, ce qui achève de les
confondre.
A la vérité ils
appuyaient leur opinion d’une remarque assez fine. "Il est visible,
disaient-ils, que le ciel est un grenier à paille ou farine, car il en sort très
souvent des nuages blonds, comme lorsqu’on vanne le blé, ou blancs, comme
lorsqu’on saupoudre le pain dans la huche."
Mais je leur
réponds que les nuages ne sont point formés par les écailles de grain ou par la
poussière de farine ; car lorsqu’ils tombent, c’est de l’eau qu'on reçoit.
D’autres, plus
policé, ont prétendu que la rôtissoire était Dieu, disant qu’elle est la source
de toutes les bonnes choses, qu’elle tourne toujours, qu’elle va au feu sans se
brûler, et qu’il suffit de la regarder pour tomber en extase.
A mon avis, ils
n'ont erré ainsi que parce qu’ils la voyaient à travers la fenêtre, de loin,
dans une fumée poétique, colorée, étincelante, aussi belle que le soleil du
soir. Mais moi qui me suis assis près d’elle pendant des heures entières, je
sais qu’on l’éponge, qu’on la raccommode, qu’on la torchonne, et j’ai perdu en
acquérant la science les naïves illusions de l’estomac et du cœur.
Il faut ouvrir son
esprit à des conceptions plus vastes, et raisonner par des voies plus certaines.
La nature se ressemble partout à elle-même, et offre dans les petites choses
l’image des grandes. De quoi sortent tous les animaux ? D’un œuf ; la terre est
donc un très grand œuf cassé.
On s’en convaincra
si on examine la forme et les limites de cette vallée qui est le monde visible.
Elle est concave comme un œuf, et les bords aigus par lesquels elle rejoint le
ciel sont dentelés, tranchants et blancs comme ceux d’une coquille cassée.
Le blanc et le
jaune s’étant resserrés en grumeaux ont fait des blocs de pierre, ces maisons et
toute la terre solide. Plusieurs parties sont restées molles, et font la couche
que les hommes labourent ; le reste coule en eau, et forme les mares, les
rivières ; chaque printemps il en coule un peu de nouvelle.
Quant au soleil,
personne ne peut douter de son emploi : c’est un grand brandon rouge qu’on
promène au-dessus de l’œuf pour le cuire doucement ; on a cassé l'œuf exprès,
pour qu’il s’imprègne mieux de la chaleur ; la cuisinière fait toujours ainsi.
Le monde est un grand œuf brouillé.
Arrivé à ce degré de sagesse, je
n’ai plus rien à demander à la nature, ni aux hommes, ni à personne, excepté
peut-être quelques petits gueuletons à la rôtissoire. Je n’ai plus qu’à
m’endormir dans ma sagesse ; car ma perfection est sublime, et nul chat pensant
n’a pénétré dans le secret des choses aussi avant que moi.
Voyage aux Pyrénées, Hippolyte Taine - 1860
|